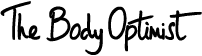Refroidir artificiellement la Terre pour lutter contre le réchauffement climatique : cela pourrait ressembler à un scénario de science-fiction. Et pourtant, c’est bien l’ambition d’un nouveau projet soutenu par le gouvernement britannique. Annoncée discrètement, l’initiative fait déjà débat.
Des expériences-tests de géo-ingénierie
L’agence ARIA (Advanced Research and Invention Agency) vient d’accorder l’équivalent de 67 millions d’euros pour financer des recherches sur la géo-ingénierie solaire, une technique aussi spectaculaire que controversée.
Le principe ? Injecter des particules dans la haute atmosphère pour réfléchir une partie des rayons du soleil et ainsi abaisser artificiellement la température de la planète. Un « parasol » à l’échelle mondiale. Si la promesse peut paraître alléchante dans un contexte d’urgence climatique, les risques potentiels, eux, font froid dans le dos.
Un « parasol planétaire » inspiré des volcans
La géo-ingénierie solaire s’inspire d’un phénomène naturel bien documenté : les grandes éruptions volcaniques. En 1991, l’éruption du mont Pinatubo aux Philippines avait propulsé dans la stratosphère d’énormes quantités de dioxyde de soufre, provoquant un refroidissement global d’environ 0,5 °C pendant plus d’un an.
Les scientifiques britanniques souhaitent reproduire cet effet de manière contrôlée en injectant, à environ 20 kilomètres d’altitude, des particules comme le soufre ou la calcite, capables de renvoyer une partie du rayonnement solaire vers l’espace. Une réduction même minime de la température pourrait, selon eux, ralentir temporairement les effets du changement climatique.
Une idée déjà testée… sur ordinateur
Ce n’est pas la première fois que cette technologie est envisagée. Depuis plusieurs années, des simulations informatiques modélisent les effets potentiels de cette manipulation du climat. Des chercheurs de Harvard avaient même voulu lancer une expérimentation réelle en 2021, baptisée SCoPEx, mais le projet avait été suspendu face à une levée de boucliers internationale, notamment de communautés autochtones et d’experts du climat.
Ce qui change aujourd’hui, c’est que le Royaume-Uni semble déterminé à franchir un cap, même à très petite échelle. Si les tests sont encore limités, l’entrée dans le monde réel de cette technologie marque un tournant dans la réflexion sur les solutions d’urgence climatique.
Une technique à haut risque environnemental
Cette solution de « dernier recours » est loin d’être neutre. Les effets secondaires redoutés sont nombreux, comme l’expliquent plusieurs experts :
- Perturbation des régimes de précipitations, avec des sécheresses dans certaines régions et des inondations ailleurs
- Réduction de l’ensoleillement, pouvant impacter la croissance des cultures
- Affaiblissement de la couche d’ozone, qui protège la Terre des rayons UV
- Dépendance technologique durable : une fois enclenché, ce système nécessiterait un entretien permanent pendant des décennies. Un arrêt brutal entraînerait une hausse soudaine et violente des températures.
Et surtout, cette approche ne traite pas la cause du problème : les émissions de gaz à effet de serre. Certains experts redoutent ainsi qu’en misant sur ce type de « solution miracle », les gouvernements relâchent leurs efforts en matière de réduction du CO₂.
Une gouvernance floue, un débat éthique explosif
Au-delà des aspects scientifiques, c’est la question de la gouvernance mondiale qui crispe.
Qui aurait le pouvoir de lancer une opération de géo-ingénierie ? Un seul État ? Un consortium ? L’ONU ? Et sur quels critères ? Si une région du monde y gagne, une autre pourrait y perdre. Le climat n’ayant pas de frontière, une action locale pourrait avoir des effets globaux… et injustes.
Ces interrogations ont conduit en 2022 plus de 390 scientifiques du monde entier à signer une lettre ouverte demandant un moratoire sur les expérimentations de géo-ingénierie solaire. Pour eux, les risques de dérive dépassent les bénéfices escomptés. Certains parlent déjà « d’apprenti sorcier du climat ».
Faut-il tout tenter pour éviter le pire ?
Les partisans de ces recherches, eux, plaident pour « la préparation au pire ». Selon les climatologues britanniques impliqués dans le projet, il ne s’agit pas de promouvoir une solution de remplacement à la réduction des émissions, mais d’envisager une option d’urgence, si la planète franchit un point de bascule irréversible, comme un effondrement du courant marin du Gulf Stream ou la fonte accélérée des calottes glaciaires.
Pour eux, il serait irresponsable de ne pas anticiper un scénario extrême. La démarche d’ARIA consisterait donc à mieux comprendre la faisabilité, les limites et les dangers de cette approche – sans toutefois l’appliquer à grande échelle dans l’immédiat.
Refroidir la Terre en détournant les rayons du soleil ? L’idée est aussi fascinante que dérangeante. Entre nécessité d’innover et appel à la prudence, le débat reste ouvert. Une chose est certaine : la meilleure solution reste de ne jamais avoir besoin d’un tel « parasol planétaire », en agissant dès maintenant pour réduire drastiquement notre impact environnemental.