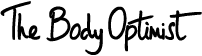Quand vous perdez à un jeu de société, vous acceptez difficilement la défaite et vous trouvez mille excuses pour retourner la partie à votre avantage. Que ce soit autour des pions, des cartes ou d’un ballon, vous jouez presque votre vie et vous refusez littéralement l’échec. Si cette étiquette de mauvaise perdante vous colle à la peau depuis l’ère des courses de sac à la maternelle, sachez que ce n’est pas juste un « détail » ou un « défaut ». Ça révèle quelques particularités sur votre personnalité.
Un besoin de reconnaissance et de justice
Déjà sur les bancs de l’école, il fallait que vous fassiez le plus de tours à la corde à sauter ou que vous marquiez le plus de buts. Même lorsque les jeux étaient amicaux, vous aviez ce besoin irrépressible de remporter la victoire. Vous étiez mauvaise perdante et ça n’a pas tellement changé avec le temps. Quand la chance n’est pas de votre côté, que les billets vous manquent au Monopoly ou que les dés ne vont pas dans votre sens au Yam, vous vous mettez dans tous vos états.
D’ailleurs, vous n’avez pas de pitié quand il s’agit de gagner. Vous devenez la plus grande stratège de tous les temps, vous retournez le cerveau des autres joueurs et vous trichez sciemment. Si vous n’arrivez pas à vos fins, vous faites les mêmes crises qu’à sept ans. Vous renversez le plateau, vous croisez les bras et on ne vous entend plus pendant le reste de la soirée. Même si « c’est juste pour le fun », vous prenez le jeu très au sérieux. Soyons honnêtes : ne pas aimer perdre est humain, presque instinctif. Dès l’enfance, on associe la victoire à la réussite et la défaite à l’échec. Cependant, si à l’âge adulte, les parties de Scrabble et le Trivial Pursuit dominical vous affectent toujours autant, c’est qu’il y a quelque chose de plus profond à creuser sur vous.
Les psychologues s’accordent à dire qu’il n’existe pas de profil unique du « mauvais perdant ». Un point commun revient souvent : ces personnes s’impliquent énormément dans tout ce qu’elles entreprennent. Elles donnent d’elles-mêmes, investissent du temps, de l’énergie, et souvent une part d’émotion. Résultat : la défaite leur semble injuste, voire insupportable. Souvent, la mauvaise perdante manque de confiance en elle. Elle cherche à travers la victoire une validation qu’elle ne trouve pas ailleurs.
Une quête de contrôle en toile de fond
D’un point de vue extérieur, la mauvaise perdante est juste une personne capricieuse qui ne sait pas contenir ses émotions. Or dans l’œil des psychologues, c’est le symptôme typique d’une personne qui a manqué d’attention pendant le tendre âge et qui a grandi sous des regards exigeants. C’est le reflet d’une personnalité perfectionniste. Gagner, c’est maîtriser la situation, anticiper, prouver qu’on est à la hauteur. Perdre, au contraire, c’est se confronter à l’imprévisible, au hasard, à la vulnérabilité.
Ce n’est pas tant la compétition qui les anime, mais la peur de ne plus rien tenir entre leurs mains. Ceux qu’on qualifie rapidement de « mauvais perdants » ont souvent grandi dans un environnement où l’erreur n’était pas valorisée. Ils ont appris que tout devait être parfait pour être accepté. Résultat : perdre, même dans un jeu, peut réveiller de vieilles blessures émotionnelles. C’est pourquoi certaines personnes réagissent de manière disproportionnée à une défaite : colère, mauvaise foi, bouderie, ou au contraire, retrait silencieux.
Une sensibilité cachée derrière l’envie de gagner
Paradoxalement, les « mauvaises perdantes » sont souvent des hypersensibles. Derrière leur apparente combativité se cache une grande perméabilité émotionnelle. Chaque revers, même anodin, est ressenti avec une intensité décuplée. Leur besoin de victoire est alors une façon de se protéger d’un trop-plein d’émotions négatives : frustration, honte, peur du jugement.
En gagnant, les « mauvaises perdantes » se rassurent, elles confirment leur place. En perdant, c’est tout leur équilibre intérieur qui vacille. Cette sensibilité n’est pas une fatalité, elle peut aussi devenir une force. Lorsqu’elle est reconnue et apprivoisée, elle permet de transformer la compétition en moteur de dépassement plutôt qu’en terrain de souffrance.
Et si apprendre à perdre était une victoire ?
Perdre n’est pas un aveu de faiblesse ni le signe d’un QI inférieur. Ce n’est pas parce que vous n’avez pas rempli votre camembert au Trivial Pursuit que vous êtes nulle. Ce n’est pas non plus parce que vous avez les mains pleines de cartes à la fin du Uno que vous allez baisser dans l’estime de vos proches. Perdre est même constructif, surtout dans le cadre des jeux de société. Si la phrase « l’important c’est de participer » ne prend pas sur vous, voici quelques pistes pour apaiser ce rapport à la défaite :
- Remettre la perte à sa juste place. Tout ne se joue pas dans un résultat. Perdre ne définit pas qui vous êtes, mais ce que vous avez tenté.
- Apprendre à perdre petit. Commencez par accepter de « ne pas être le meilleur » dans des situations anodines : un jeu entre amis, un débat, un projet. Cela désensibilise le cerveau à l’échec.
- Valoriser le processus, pas la performance. Célébrer les efforts, la progression et l’apprentissage permet de déplacer la valeur personnelle du « résultat » vers « l’expérience ».
- Accueillir l’émotion. La frustration fait partie du jeu. L’idée n’est pas de l’étouffer, mais de la reconnaître sans s’y noyer.
Si les mauvaises perdantes ont tendance à se mettre tout le monde à dos, en réalité, elles cherchent l’approbation des autres. Cependant, votre valeur ne se définit pas dans un jeu de cartes ou à travers quelques bonnes pioches. Le seul exercice que vous devez réussir est celui de l’amour-propre. La règle pour y parvenir ? Être soi-même, sans honte.