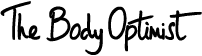C’est un livre qui est déjà passé entre de nombreuses mains. Salué presque unanimement par la critique et décoré de plusieurs prix, le roman “Mon vrai nom est Elisabeth” de Adèle Yon ne laisse personne insensible. Ce récit porte sur la santé mentale des femmes à une époque où elles étaient cataloguées hystériques lorsqu’elles parlaient un peu fort ou enfermées d’office quand elles n’avaient pas ce prétendu instinct maternel. Cette histoire, c’est celle de sa grand-mère, affectueusement nommée Betsy et qui frôle l’irréel tant elle est sinistre.
Une enquête intime qui se transforme en cri universel
Il y a des livres qu’on lit, puis qu’on range. Et il y a ceux qui continuent de résonner bien après la dernière page. C’est l’effet que provoque Mon vrai nom est Élisabeth, le premier récit d’Adèle Yon. Ovationné par la critique, porté par un bouche-à-oreille fulgurant, ce texte hybride est en train de devenir un véritable phénomène.
Ce roman fait partie de ceux qui marquent les esprits, qui laissent une trace de leur passage dans les librairies et qui éveillent les consciences. Celui-ci, il ne se contente pas de nous distraire sur le sable chaud, il nous bouscule de l’intérieur et nous montre une réalité de l’ombre. Nous sommes spectateurs du mal-être des femmes à une époque où la santé mentale est un mot inconnu et où les diagnostics sont vite prononcés.
Tout commence par une quête personnelle. À 25 ans, en plein cœur d’une relation toxique, Adèle Yon se met à douter de sa santé mentale. Les vieux récits familiaux, les silences lourds et les regards fuyants ravivent une question angoissante. “Et si la « folie » se transmettait de femme en femme ?” Quelques années plus tard, elle tombe sur une photo qui change tout. Dessus, une femme au regard absent, les tempes marquées par les stigmates d’une lobotomie.
C’est Élisabeth, son arrière-grand-mère, un prénom empreint de mystère qui sonne presque interdit. Disparue des tableaux de famille et rayée des souvenirs, cette aïeule semble avoir emporté de nombreux secrets dans sa tombe. Et Adèle compte bien percer la vérité à jour. Elle exhume des archives, des correspondances, des rapports médicaux. Sa quête intime se transforme alors en enquête historique et féministe, où se mêlent mémoire familiale et mémoire collective.
Voir cette publication sur Instagram
Élisabeth, ou le destin volé d’une femme
Le brouillard se dissipe autour de cette histoire, passée sous silence pendant des décennies. Celle que tout le monde appelait tendrement Betsy était une femme des années 1940 au tempérament jugé « trop vif », « trop dérangeant ». Née à la mauvaise époque, elle n’était pas du genre à jouer les figurantes au bras de son conjoint et à obéir aux ordres.
À seulement 23 ans, elle a embrasé le château où elle était supposée se marier comme un acte de rébellion. Puis finalement, les conventions de son ère l’ont rattrapé. Mariée à un homme autoritaire, mère malgré elle de six enfants, elle a traversé une succession de grossesses imposées et d’épisodes dépressifs que personne ne cherchait à comprendre. À ce moment-là, la dépression post-partum ne relevait pas de l’évidence. Qu’une mère ne se plaise pas dans son rôle n’était même pas envisageable.
En 1950, sur décision son mari et avec l’aval de la psychiatrie de l’époque, elle subit alors une lobotomie, une opération effroyable consistant à sectionner une partie du cerveau. De là, plus de dix-sept années d’internement. La jeune femme flamboyante devient une ombre, effacée, docile. Elle sortira trop tard, rejetée par les siens, jusqu’à s’éteindre dans la plus plate indifférence à l’aube des années 1990.
À travers cette histoire, c’est toute une époque qui se dessine : celle où les femmes jugées trop libres, trop fragiles ou simplement trop présentes étaient médicalement « corrigées ». Ce récit cinglant inscrit noir sur blanc pourrait se confondre avec un script de Hitchkok ou d’autres grands conteurs d’horreur. Pourtant il n’est que le reflet d’un siècle où la détresse des femmes n’avait que la violence pour réponse. Celle de la lobotomie, de la camisole ou des électrochocs. Ce livre nous ouvre les yeux sur une réalité, qui a longtemps été remodelée par les hommes.
Un succès littéraire qui dépasse les frontières
Aujourd’hui, Mon vrai nom est Élisabeth dépasse largement le cercle des initiés. Déjà traduit dans une douzaine de langues et vendu à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, le livre passionne autant les lecteurs que les critiques. Les superlatifs pleuvent : « prodigieux », « bouleversant », « inoubliable ».
Pourquoi un tel engouement ? Parce qu’Adèle Yon a trouvé le ton juste. Ni simple roman, ni essai académique, son texte oscille entre autofiction, plaidoyer et enquête. On y entre comme dans un polar. On en sort avec une réflexion vertigineuse sur la mémoire, l’héritage et les récits que l’on transmet.
Ce livre, qui raconte ce que les manuels d’histoire omettent, rend hommage à toutes ces oubliées de la société. Celles, qui, un jour, ont fini entre quatre murs avec une blouse blanche sur le dos pour avoir parlé trop fort, rétorqué, pas assez apprécié leur maternité ou simplement donné leur opinion. Celles qui ont écopé d’un traitement inhumain alors qu’elles ne demandaient parfois qu’une main tendue ou une oreille attentive.
Le livre Mon vrai nom est Élisabeth est comme un « je te crois » à toutes ces femmes du siècle dernier. Plus qu’une réussite littéraire, c’est un geste de réparation. En redonnant un visage et une voix à Élisabeth, Adèle Yon réhabilite toutes celles qu’on a voulu museler, dresser, dominer. Elle fait ce que Anne Frank a fait avec les victimes de l’Holocauste : elle redonne du pouvoir à celles qui en ont manqué à un instant précis.