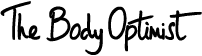À l’approche d’Halloween, sursauter est presque une nécessité. Pourtant, à la base, l’être humain n’est pas programmé pour se figer devant des clowns maléfiques ou trembloter à la vue de poupées désarticulées. Alors qu’à l’âge adulte, on se glace face à une araignée et on panique dans les espaces confinés, à la naissance nous n’avons que deux peurs. Toutes les autres sont créées de toutes pièces.
Les deux seules peurs naturelles : la chute et le bruit
Des chercheurs en psychologie infantile l’ont démontré dans les années 1960 à travers l’expérience du « précipice visuel », menée auprès de bébés de quelques mois. En plaçant un sol transparent imitant une falaise, ils ont observé que les nourrissons refusaient d’avancer. Résultat : même sans avoir jamais chuté, les bébés ressentent une peur instinctive du vide.
La seconde peur innée ? Celle des bruits forts. Un claquement soudain, une porte qui claque, un cri : les nourrissons sursautent, leur rythme cardiaque s’accélère, leurs muscles se contractent. Ces deux réflexes sont des mécanismes de survie primitifs, hérités de nos ancêtres. Ils servaient à nous protéger du danger physique immédiat : tomber d’une falaise, fuir un prédateur.
Toutes les autres peurs, en revanche, ne sont pas programmées dans notre ADN. Elles se construisent, lentement, à mesure que notre cerveau apprend à interpréter le monde. En clair, elles sont contagieuses et se forgent dans le regard des gens qui nous entourent. Il suffit de voir un adulte surréagir face au plus inoffensif des serpents ou se crisper au milieu de la foule pour que sa peur devienne nôtre.
Des peurs apprises (et souvent héritées)
La science parle ici de peurs acquises, ou conditionnées. En grandissant, nous associons certains stimuli à des émotions négatives. Une morsure, et la peur des chiens s’installe. Une remarque blessante, et la peur du jugement germe.
Mais cette construction ne vient pas uniquement de nos propres expériences. Nous héritons aussi des peurs des autres : nos parents, nos proches, nos pairs. Si une mère sursaute en voyant une araignée, son enfant intégrera inconsciemment que cette réaction est la bonne. C’est ce que les chercheurs appellent l’apprentissage social de la peur.
Nos peurs se transmettent ainsi de génération en génération, comme des récits invisibles. Elles deviennent des repères émotionnels qui nous aident à anticiper les dangers, parfois réels, souvent imaginaires.
Reprogrammer son rapport à la peur
Selon les neuroscientifiques, l’exposition progressive à ce qui nous effraie est l’un des moyens les plus efficaces pour reprogrammer nos circuits neuronaux. C’est le principe même des thérapies cognitivo-comportementales (TCC) : confronter doucement le cerveau à la source de son angoisse, jusqu’à ce qu’elle perde de sa charge émotionnelle.
Les techniques de relaxation, la méditation ou la cohérence cardiaque peuvent également réduire la réactivité émotionnelle du système nerveux. En calmant le corps, on apaise aussi le mental. Et surtout, en comprenant que nos peurs ne sont pas figées, mais le fruit d’un apprentissage, on reprend du pouvoir sur elles.
Ces peurs résultent aussi d’une pression sociale à « faire comme tout le monde » et à se conformer aux attentes. Maintenant que vous savez que vous ne naissez qu’avec deux peurs, toutes les autres vont vous sembler bien ridicules. Quoi que, il serait bien triste de rester impassible devant les films d’épouvante le soir du 31.