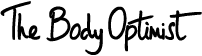Rester dans un emploi qui ne nous satisfait plus, par peur de l’inconnu ou du chômage, est une réalité pour de nombreux salariés. Ce phénomène porte un nom : le « job cuffing ». Selon une récente étude, 72% des actifs adopteraient ce comportement sans même en avoir conscience.
Qu’est-ce que le job cuffing ?
Le job cuffing désigne l’attitude de salariés qui restent dans leur poste, malgré un manque d’épanouissement ou d’intérêt, simplement par sécurité. Ils préfèrent la stabilité à la prise de risque, notamment en période d’incertitude économique. Ce comportement se manifeste souvent par une implication minimale, sans volonté d’évolution ou de changement, uniquement pour éviter les difficultés liées à la recherche d’un nouvel emploi.
Pourquoi autant de salariés sont concernés ?
D’après les experts, cette aversion au risque s’explique par la peur du chômage, la précarité du marché du travail ou encore une perception erronée des opportunités disponibles. Beaucoup de collaborateurs restent ainsi « menottés » à leur poste, pensant qu’il n’existe pas d’alternatives viables. Pourtant, de nombreux secteurs continuent de recruter et des postes restent vacants, faute de candidats.
Les conséquences du job cuffing
Si le job cuffing peut sembler rassurant à court terme, il s’avère néfaste sur la durée. L’employé s’expose à une perte de motivation, un sentiment d’épuisement, voire un risque de burn-out. Pour l’entreprise, cela se traduit par une baisse de productivité, une ambiance dégradée et un manque d’innovation. Le dialogue entre salariés et employeurs, ainsi que la mise en place de perspectives d’évolution, sont essentiels pour éviter cette routine délétère.
Pour briser ce cercle vicieux, il est ainsi recommandé d’élargir sa vision du marché du travail, de se renseigner sur les secteurs en tension et de dialoguer avec sa hiérarchie. Les employeurs ont également un rôle à jouer en favorisant la mobilité interne, la formation et un climat de bien-être propice à l’épanouissement professionnel.