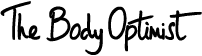Derrière l’apparente équité dans la gestion des finances du couple, un déséquilibre structurel reste invisible : la « théorie du pot de yaourt » de Titiou Lecoq met à nu une mécanique qui pénalise les femmes sur le long terme.
Comment fonctionne la « théorie du pot de yaourt » au quotidien
Titiou Lecoq observe que, dans de nombreux foyers, les femmes assument la plupart des dépenses quotidiennes : alimentation, petits achats, frais cycliques – symbolisés par les pots de yaourt. Les hommes, souvent bénéficiaires d’un salaire plus élevé, financent les dépenses et investissements majeurs comme la maison ou la voiture. Lors d’une séparation, la femme quitte le couple sans patrimoine ni objets durables : juste « le pot de yaourt vide ».
Voir cette publication sur Instagram
De l’invisible à la fracture économique
Le concept montre que le travail invisible des femmes (courses, entretien, charge mentale) ne crée pas de richesse transmissible. Cela nourrit une dette émotionnelle et un sentiment d’effacement, d’autant plus fort lorsque la précarité post-séparation s’installe, contrastant avec l’enrichissement du partenaire.
Reconnaissance, transmission et culture financière
Ce phénomène ne concerne pas que le présent : l’absence de patrimoine à transmettre creuse la fracture générationnelle, privant les femmes et leurs filles d’héritage économique. Plusieurs initiatives émergent pour encourager la culture financière et l’investissement chez les femmes, rompre le cercle de l’appauvrissement et favoriser plus d’équité.
La « théorie du pot de yaourt » questionne ainsi la justice au sein du couple : elle montre que la liberté financière et l’égalité passent par une réelle répartition et la reconnaissance du travail invisible des femmes.