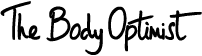#MeTooPolitique, #MeTooGHB, #MeTooMédias… #MeToo s’est fait entendre dans les mondes du sport, des bars, des lycées, de l’Église, dans les sphères familiales et plus encore. Ce hashtag a permis de libérer la parole des victimes, qui ont longtemps subi la honte et la culpabilité, en plus de la violence. Le développement du mouvement met aussi en lumière les dysfonctionnements de la société. Aujourd’hui, en 2021, les mentalités ont-elles vraiment évolué ? Pour répondre, voici une rétrospective – non exhaustive – du mouvement #MeToo, et une observation de ce qui a changé dans les mentalités et les instances de décision, 4 ans après.
#MeToo, un mouvement invisibilisé dès 2006
Fin 2021, les prédateurs sexuels ont-ils tous chuté de leur piédestal, emportés par la vague planétaire #MeToo ? Pas sûr. Le 15 novembre dernier, 285 femmes travaillant dans le milieu politique ou universitaire signaient « Pour un #MeToo politique : les agresseurs sexuels n’ont pas leur place aux élections de 2022 ». Cette tribune, publiée dans Le Monde, vise à éveiller les consciences à l’aube de deux élections majeures en France.
Le 9 novembre, le quotidien français Libération publiait lui une longue enquête sur l’affaire des 8 femmes accusant Patrick Poivre d’Arvor de viol, agression sexuelle et de harcèlement. Puis il y a eu aussi, rien que cette année, les nombreux témoignages glaçants des mouvements #MeTooInceste et #MeTooGay. 4 ans après le début du mouvement, #MeToo continue ainsi de mettre en lumière les violences sexistes et sexuelles tues dans de nouvelles sphères de notre société.
Le mouvement MeToo a démarré en 2006 avec Tarana Burke, travailleuse sociale et militante afro-américaine. Survivante d’agressions sexuelles, elle a accompagné d’autres victimes, particulièrement les jeunes filles noires, qu’elle sait être les plus invisibilisées. Son mouvement intitulé MeToo visait à dire à ces femmes : « Vous êtes entendues, vous êtes comprises, vous n’êtes pas seules ». En octobre 2017, le mouvement #MeToo voyait le jour lorsque plusieurs femmes accusaient le producteur hollywoodien Harvey Weinstein pour harcèlement sexuel. Dans la foulée, le 13 octobre, la journaliste Sandra Muller lance le hashtag #BalanceTonPorc en France. Sans le savoir, l’actrice Alyssa Milano reprend l’idée du « moi aussi » de Tarana Burke, dans un tweet le 15 octobre 2017. En l’espace d’un an, ce hashtag comptera plus de 17,2 millions de tweets et se propagera via les réseaux sociaux dans 85 pays.
Ce que #MeToo a changé, un an après
Le 1er janvier 2018, l’association Time’s Up est créée par 300 femmes influentes (actrices, agentes et scénaristes) à Hollywood pour lutter contre le harcèlement et les inégalités au travail. En quelques jours, quinze millions de dollars sont levés. Un an après le début du mouvement #MeToo, en septembre 2018, l’acteur Bill Cosby est condamné à dix ans de prison pour agression sexuelle. C’est la première grande condamnation symbolique du mouvement.
En France, durant l’été 2018, la loi Schiappa a introduit un durcissement des sanctions envers les agresseurs dans l’espace public. La vidéo de Marie Laguerre, jeune étudiante qui a été violentée en public en juillet 2018, a fait le buzz. Son agresseur a été condamné à 6 mois de prison ferme.
« Le fait que le parquet ait ouvert une enquête est totalement lié à la médiatisation, mais aussi à la loi et à #MeToo. Cela aurait-il été possible il y a deux ans ? Disons que, cette fois, les étoiles étaient alignées », expliquait alors l’étudiante.
Aux États-Unis, en Espagne ou en Argentine, la France n’avait pas encore connu de grande « marche des femmes » après le mouvement #MeToo. Mais le 24 novembre 2018, des milliers de manifestant.e.s ont défilé dans toutes les villes de France à l’appel de #NousToutes pour appeler à la fin des violences sexistes et sexuelles. Un raz-de-marée violet qui a marqué les esprits et l’engagement féministe.
Des changements de perception sur les violences sexuelles ?
Dans une enquête réalisée en 2018 par la Fondation des femmes, 71 % des femmes ayant subi des violences ont déclaré avoir trouvé le courage de témoigner, grâce au mouvement #MeToo. Et 95,7 % d’entre elles ont considéré que cela a été une expérience positive pour elles. Des chiffres qui se sont reflétés dans les statistiques du 3919, le numéro d’urgence pour les femmes victimes de violence.
Au niveau des mentalités, plusieurs enquêtes ont été menées. Selon un sondage Harris Interactive de 2018, un peu plus d’une personne sur deux (53 %), jugeait que #MeToo n’avait rien changé. Les hommes étaient plus nombreux que les femmes à considérer que #MeToo avait eu des conséquences plutôt négatives (16 % contre 7 %), et plus de femmes estimaient que rien n’avait vraiment changé (57 % contre 49 %).
Une autre étude a été menée auprès de la population britannique par la Fawcett Society cette même année. Elle a observé une « évolution significative des comportements face au harcèlement sexuel », en particulier chez les hommes. Depuis #MeToo, une majorité de 53 % des sondé.e.s a changé sa définition de ce qui est acceptable de faire ou non, surtout chez les 18-24 ans. Et 58 % des jeunes garçons se disaient prêts à s’opposer ouvertement au harcèlement sexuel. Si ce n’était pas le cas pour les plus âgé.e.s, il.elle.s reconnaissaient avoir (récemment) observé un changement flagrant des limites « posées ».
#MeToo, une victoire en demi-teinte
Malgré ces nouvelles plutôt prometteuses pour le mouvement #MeToo, l’année 2020 a fait ressortir un débat dans l’opinion publique « peut-on séparer l’homme de l’artiste ? ». En référence au prix de la meilleure réalisation décerné à Roman Polanski lors de la cérémonie des Césars, malgré ses nombreuses accusations d’agressions sexuelles et pédophiles. Le mouvement #MeToo, qui n’a pourtant pas arrêté de pointer le milieu du cinéma, s’est alors pris une claque. En célébrant un homme qui a reconnu sa propre agression sur une adolescente de 13 ans, quel message envoie-t-on aux victimes de viols ? L’actrice Adèle Haenel, marquera les esprits en quittant la cérémonie et en criant « la honte ! ».
Beaucoup de choses ont évolué depuis le lancement du mouvement #MeToo. Ce n’est certainement pas parfait, mais les victimes craignent beaucoup moins de s’exprimer, et ce dans plus en plus de domaines de notre société. Ni la justice, ni les médias, ni les gouvernements ne peuvent aujourd’hui ignorer l’ampleur des violences sexistes et sexuelles. Cependant, à chaque nouveau scandale, on continue de remettre en question la véracité des témoignages des victimes.
Combien de #MeToo seront encore nécessaires pour que les mentalités changent réellement, et surtout pour que ces agressions cessent ?
Et vous, que pensez-vous du mouvement #MeToo aujourd’hui ? Venez partager vos impressions avec nos lecteurs et lectrices, sur notre forum.