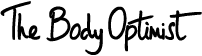Souvent relégué au rang d’accessoire de mode, le sac à main raconte en réalité bien plus que l’histoire du style. Objet du quotidien, il est aussi un témoin de l’intime, un outil de survie, un symbole d’autonomie – et parfois, une arme de résistance.
Une extension du corps et de l’histoire
Depuis des siècles, les sacs accompagnent les femmes dans l’espace public. À l’inverse des vêtements qui épousent le corps, le sac à main s’en détache physiquement, tout en devenant une extension symbolique de soi. Il contient l’essentiel et l’accessoire, le visible et le secret. À travers lui, chaque femme transporte un peu de chez elle, de ses priorités, de ses peurs, et de ses besoins.
Dans The Things She Carried, la chercheuse Kathleen B. Casey retrace l’histoire culturelle du sac à main, en mettant en lumière son rôle souvent ignoré dans les luttes sociales, les constructions identitaires et les trajectoires individuelles. Bien plus qu’un objet de consommation, il est un outil de pouvoir, parfois discrètement brandi, parfois frontalement revendiqué.
Un instrument d’autonomie
Le sac est aussi un espace de liberté : là où les vêtements dits féminins offrent peu ou pas de poches, il devient une nécessité. Il permet de transporter de quoi se soigner, se défendre, s’exprimer, travailler, et faire face à l’imprévu. Dans certains contextes, il a même offert un espace de négociation avec le monde extérieur, un rempart entre l’intime et le public.
Kathleen B. Casey raconte ainsi comment, en 1943, Rosa Parks avait utilisé son sac à main pour revendiquer une place dans le bus réservé aux Blancs, bien avant le geste historique de 1955 qui l’a rendue célèbre. Plus tard, durant le mouvement des droits civiques, les femmes noires cachaient dans leurs sacs des objets essentiels pour faire face aux violences : documents, médicaments, nourriture, outils d’auto-défense.
Un objet politique
Le sac à main a souvent été un marqueur de genre, voire un objet de stigmatisation. Les femmes « butch », par exemple, s’en détournaient volontairement pour ne pas répondre aux normes féminines attendues.
À l’inverse, certaines figures emblématiques de la communauté LGBTQ+ s’en sont saisies pour inverser le stigmate : Marsha P. Johnson, icône de Stonewall, utilisait son sac rempli de briques comme arme de résistance face à la police. L’objet prend alors une dimension politique, sociale, et symbolique. Il est à la fois le reflet d’une condition et un outil d’émancipation.
Le sac comme mémoire collective
Dans son ouvrage, Kathleen B. Casey explore aussi des épisodes historiques marquants où le sac devient un témoin. Lors de l’incendie tragique de l’usine Triangle Shirtwaist en 1911 à New York, ce sont par exemple parfois les sacs à main qui ont permis d’identifier les victimes.
Dans ce contexte, les sacs étaient à la fois objets de surveillance – les employées devaient les faire inspecter – et objets de dignité. Loin d’être un simple « pocketbook », le sac devient un espace de mémoire. Un lien entre générations, une archive mouvante de ce qui compte, de ce qui protège.
Une redéfinition contemporaine
Aujourd’hui encore, le sac n’est jamais neutre. Il dit quelque chose de notre rapport au monde, à notre genre, à notre sécurité, à notre statut social. Il peut être un marqueur de mode, une revendication féministe, ou encore un simple besoin pratique. Il peut être un geste de soin envers soi-même ou un signal envoyé aux autres.
En révélant les multiples fonctions du sac – utilitaire, affective, symbolique, politique – Kathleen B. Casey nous invite ainsi à reconsidérer ces objets du quotidien. Le sac à main n’est pas un simple contenant : c’est un corps extérieur, un refuge mobile, et souvent, une forme discrète de résistance.