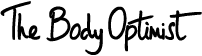Après une décennie marquée par la montée de la diversité corporelle, les mannequins dites grande taille alertent : les opportunités s’amenuisent. Dans un secteur influencé par les nouvelles normes de minceur liées aux traitements amaigrissants comme Ozempic, la mode semble renier l’ère de la « body positivity ».
Le retour d’un « idéal mince » : quand la mode oublie la diversité
Il fut un temps où l’on croyait la mode prête à changer. Quand Ashley Graham a foulé le podium de Michael Kors, ou que Tess Holliday posait fièrement pour Cosmopolitan UK, le monde a applaudi : enfin, les formes, les tailles 44 et plus avaient trouvé leur place sous les projecteurs. Les hashtags #BodyPositive et #AllBodiesAreBeautiful saturaient Instagram, les marques promettaient inclusion et représentation. L’air du temps semblait respirer la bienveillance.
Comme souvent dans la mode, les tendances tournent aussi vite qu’un défilé de 10 minutes. Le vent de la diversité a ainsi faibli. À la place, un « nouvel idéal » s’est imposé, façonné par les « chirurgies miracles » et les filtres de téléphones : celui du corps ultra-mince, presque irréel. La « culture Ozempic » – cette obsession pour les médicaments amaigrissants – a balayé les podiums et les campagnes publicitaires. Résultat ? Les mannequins dites grande taille se retrouvent à nouveau relégués à la marge, après avoir cru à une vraie révolution.
Saffi Karina : une carrière freinée par la minceur
Vous avez peut-être déjà aperçu son sourire en couverture de Vogue ou dans une campagne pour H&M. Son parcours, souvent cité comme exemple de réussite pour les mannequins « curve », cache pourtant un revers amer. Dans une interview accordée au Daily Mail, Saffi Karina confie que les castings haute couture ne cherchent plus « de diversité corporelle ». Les demandes se raréfient, les visuels se standardisent. « On a coché la case diversité, sans réelle conviction », regrette-t-elle.
Derrière cette phrase se cache un constat glaçant : la mode a fait de l’inclusivité une stratégie marketing plus qu’un engagement durable. « Les marques ont voulu paraître progressistes, pas l’être réellement. Dès que la tendance a changé, elles ont refermé la porte », explique-t-elle. Saffi continue à travailler, bien sûr, mais les contrats se font plus rares, plus timides. « C’est comme si on voulait que je sois visible, mais pas trop. Présente, mais pas au centre ».
Voir cette publication sur Instagram
Tess Holliday : quand la « culture Mounjaro » dévore la diversité
Tess Holliday n’a jamais eu peur de secouer l’industrie. Sur le plateau de Good Morning Britain, la mannequin américaine a dénoncé le retour d’un « idéal de maigreur » qu’elle pensait révolu. « La société a basculé. Les marques ne trouvent plus le corps vendeur ».
Cette phrase résume tout : le corps des femmes – quel qu’il soit – reste perçu comme un produit. Et dans cette logique commerciale, la minceur redevient synonyme de luxe, d’aspiration, de « discipline ». Tess, qui a bâti sa carrière sur la fierté de son corps, doit désormais chercher d’autres sources de revenus. Le mannequinat, autrefois son terrain de jeu et de combat, se referme sur elle.
Voir cette publication sur Instagram
Un idéal de beauté toujours inatteignable ?
Les chiffres et les visuels parlent d’eux-mêmes. Les podiums affichent de nouveau des silhouettes longilignes, presque adolescentes. Même certaines marques qui se voulaient inclusives réduisent peu à peu leur diversité de tailles dans les campagnes récentes. Zara, quant à elle, a été critiquée pour avoir mis en avant des mannequins « dangereusement maigres » dans ses dernières collections.
Pour Esther Boiteux, directrice de casting parisienne, « la minceur reste associée au chic et à la richesse ». Le problème est culturel autant qu’économique : la mode continue à vendre un rêve inaccessible. « Plus mince », « plus lisse », « plus parfait ». « La diversité, c’était bien tant qu’elle servait l’image d’ouverture. Maintenant, elle gêne le récit du retour à la ‘pureté’ des lignes », analyse-t-elle.
Heureusement, quelques voix refusent de se taire. La créatrice Jeanne Friot, connue pour ses défilés gender-fluid et inclusifs, milite par exemple pour une mode où « toutes les tailles, tous les âges et toutes les origines » ont leur place. Même pour elle, le combat est toutefois inégal : « On ne peut pas parler d’inclusion si les vêtements ne sont pas pensés dès la conception pour tous les corps. Les tailles dites extrêmes, grandes ou petites, sont encore exclues de la production standard ».
En résumé, la « vague body positive » a prouvé une chose : le public veut voir de la diversité. Il réclame des campagnes où chaque personne peut se reconnaître. « La mode nous a fait croire qu’elle changeait, mais elle n’a fait que cocher une case », conclut Saffi Karina. Pourtant, il serait injuste de conclure à la défaite totale. Car chaque campagne qui ose montrer un ventre, une cicatrice, une taille 50 (et plus), ébranle un peu plus les vieux codes. La mode n’est peut-être pas encore totalement prête à célébrer toutes les formes, mais le regard du public, lui, évolue.